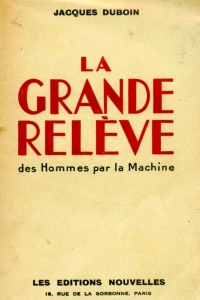Le chômage a toujours été stigmatisé comme un fléau, et nous ne sommes d’ailleurs pas en reste sur ce site. Seulement en prenant du recul, il se pourrait bien qu’il ne soit en réalité que la manifestation du progrès technique, et du remplacement progressif de l’homme par la machine. Ce texte de 1932, extrait de « La grande relève » de Jacques Duboin, défend l’idée qu’un taux d’inactifs élevé n’est pas un aveu d’échec mais au contraire un gage de succès pour une civilisation. Et que c’est notre manière de l’appréhender – en stigmatisant les chômeurs – qui est la source de nos difficultés. En élevant le débat à un niveau quasiment philosophique l’auteur nous fait partager un point de vue qui vaut le détour, à l’heure ou nous devons faire des choix structurels pour notre société.
L’ouvrage est disponible en intégralité en PDF ici ou bien sur ce site (à qui nous devons cet extrait).
Ci-dessous, extrait des pages 287 et suivantes, chapitre intitulé « La grande relève »: Hermodan, sage ermite vivant sur une montagne, prend la parole.
« — Je ne vois pas pourquoi la race humaine serait condamnée au travail à perpétuité. Ou alors il ne fallait pas la doter d’un cerveau grâce auquel elle oblige la matière à travailler à sa place. Des trésors de patience et d’intelligence ont été dépensés par des générations et des générations, pour inventer et mettre au point des machines qui, de plus en plus, remplacent le travail des hommes. Nous assistons aujourd’hui à la grande relève des travailleurs par la matière disciplinée et animée d’une force de production. Ne peut-on concevoir une évolution du capitalisme qui tienne compte de cette relève, sans obliger l’armée qui descend des lignes à mourir de faim ?
Au cours des siècles passés, tous les hommes, sans exception, étaient mobilisés pour la guerre, incessante et sans merci, que la faim, la soif et le froid font à notre pauvre humanité. Tout le monde devait gagner sa vie au prix de la sueur de son front, et passer tous les jours dans les tranchées du champ de bataille.
Mais voici que, comme au cours de la grande guerre, la défense s’organise, le matériel vient se substituer, en partie, aux poitrines vivantes. Il faut des effectifs de plus en plus réduits pour tenir les lignes contre l’ennemi héréditaire : la misère humaine. Les hommes sont relevés de la fournaise ; petit à petit, ils sont libérés de l’obligation de lutter pour leur vie. Ces soldats qui descendent vers l’arrière, ce sont des libérés, des hommes dont on n’a plus besoin puisque, sans leur présence au chantier, la communauté possède enfin tout ce qui lui est nécessaire.
Les libérés d’autrefois s’appelaient les rentiers. Aujourd’hui, ce sont les chômeurs. Les uns comme les autres ne sont pas indispensables pour la production des richesses. Jamais les récoltes n’ont été plus abondantes, ni les stocks plus élevés.
Un pays devrait être fier du nombre d’hommes dont le progrès permet d’économiser l’effort. Le chômeur, au lieu d’être la rançon de la science, devrait en être la récompense. Plus il y a de chômeurs dans un pays, plus le niveau intellectuel, plus l’étiage économique est élevé. Théoriquement, n’est-ce pas vrai ?
— Vous m’effrayez, fit le propriétaire terrien.
— Qu’y a-t-il d’effrayant ? répliqua tranquillement Hermodan ? Voici deux pays de même population. L’un comme l’autre produisent, chaque année, la même quantité de richesses, mais, dans le premier, ce résultat est obtenu grâce à l’effort intensif de tous les travailleurs ; dans l’autre, grâce au travail de la moitié seulement de la population. Laquelle de ces deux nations possède le niveau intellectuel, social, économique, — mettez l’adjectif qui vous plaira, — le plus élevé ? La seconde évidemment. Cependant, ce pays privilégié est à plaindre, car la moitié de sa population, réduite à ne rien faire, est condamnée à mourir de faim et de froid. Voilà le drame que nous vivons.
Transposons le problème sur un autre plan. Il n’y a pas que les hommes que le progrès technique a délivrés, en partie, du travail obligatoire. Il y a aussi les chevaux. Ceux-ci sont remplacés, de plus en plus, par les chevaux-vapeur qu’on élève dans les cylindres d’un moteur à explosions. Le travail des chevaux en chair et en os devient de moins en moins nécessaire. Comme dit mon ami Joseph Dubois, connaissez-vous des chevaux chômeurs ?
— Expliquez-vous, dit le propriétaire terrien.
— Très volontiers, reprit Hermodan. Comme on a trouvé inutile de nourrir les chevaux à ne rien faire, on s’est empressé, dès qu’on a eu moins besoin de leurs muscles, d’en envoyer quelques uns à la boucherie, et de limiter la saillie des juments. Est-ce le sort que vous réservez aux hommes dont le travail est accompli par des machines ?
— Le chômage serait donc un bien ? dit timidement le propriétaire terrien.
— Théoriquement, il est la preuve irréfutable que le pays où il sévit a réalisé de grands progrès techniques dans la production, répondit Hermodan. Théoriquement toujours, ces hommes qui ne sont plus obligés de tenir la tranchée, ces hommes qui ont été relevés par les machines, sont le signal qu’une victoire a été remportée par le commandement, c’est-à-dire par l’intelligence. La présence de ces affranchis devrait être un élément de confiance, de réconfort, de fierté pour toute la nation. Mais c’est à la nation qu’il incombe de les faire vivre. Elle s’en acquitte un peu partout sous forme d’indemnités de chômage. Seulement, on espère, dans l’état actuel des esprits, que ces secours sont passagers et ces libérés ne sont que des permissionnaires ; qu’ils vont bientôt être forcés de remonter aux tranchées et de reprendre leur métier de galérien en travaillant le plus d’heures possibles tous les jours. On souhaite que, pour obtenir ce résultat admirable, le niveau industriel baisse prochainement. Quelques uns vont jusqu’à rêver qu’on démolissent une partie de ces esclaves-matière ou chevaux-vapeur, afin de replacer leur fardeau sur des épaules de chair. Que tout le monde retourne au bagne, c’est à cela que s’emploient les experts qui veulent mettre fin au bienfaisant chômage.
Malgré la stupéfaction indignée de tous ses auditeurs, Hermodan continua froidement :
— Évidemment, je m’aperçois que ce que je vous dis vous surprend légèrement. J’insisterai donc en affirmant que, du moment que vous n’avez plus besoin de ces hommes, vous êtes dans l’obligation absolue de les faire vivre sans travailler. Car du moment qu’ils sont venus au monde, ils ont droit à la vie. Ils y sont venus comme tous leurs frères, nus, sans poches remplies sur les côtés. Est-ce leur faute si toutes les richesses qui existent ont déjà un propriétaire légitime ? Et si l’abondance de ces richesses est telle que vous préférez les détruire ? Ah ! pour légitimer cette appropriation de tout ce qui est nécessaire à la vie, la société a élevé le travail à la hauteur d’une véritable religion. Ils ont accepté cette loi, bien qu’elle dût leur paraître dure, et ils se sont mis courageusement à l’œuvre. Mais voilà que, grâce au progrès technique, leur travail ne vous est plus nécessaire ! C’est cependant leur unique bien, qu’ils sont forcés d’échanger contre le morceau de pain indispensable à la vie. Concluez ?… Préférez-vous les faire disparaître comme les chevaux ? C’est la solution des anthropophages. Elle paraît tellement odieuse que, dans tous les pays, c’est l’État qui vient en aide à ces soi-disant déshérités. Vous savez, d’ailleurs, qu’une attitude différente conduirait droit à la révolution, car ils sont de plus en plus nombreux. Aujourd’hui 30 millions, demain 35, 40, 50 millions ! Il n’y a pas de raison pour que ça s’arrête, puisque l’idéal du progrès technique est la suppression totale de la main-d’œuvre.
— Mais comment cette situation a-t-elle pu naître si brusquement, dit enfin le propriétaire terrien, qui fut le premier à reprendre ses esprits.
— Je vous ai expliqué déjà qu’elle menaçait depuis longtemps. La guerre a précipité les événements qui, sans elle, ne se seraient produits que beaucoup plus tard, mais qui se seraient produits tout de même.
— Et c’est vraiment sans appel ? risqua l’industriel.
— Sans appel, reprit Hermodan. Il faut en prendre une bonne fois son parti. Certes vous aurez des hauts et des bas, de petites reprises suivies de dépressions profondes. Mais franchement, je croyais que nous avions épuisé le sujet et que notre religion à tous était faite et archifaite. Croyez-vous encore au retour de la prospérité telle qu’on convenait de la définir autrefois ?
— Non, évidemment, dit l’industriel, mais tout de même…
— Croyez-vous sérieusement, interrompit Hermodan, que le monde revive l’année 1929 qui, si je ne me trompe, fut l’année de la prospérité exceptionnelle ?
— Non, dit l’industriel, 1929 fut évidemment une période unique ; c’est une époque qu’on ne revivra plus.
— Je ne vous le fais pas dire, reprit Hermodan. Sachez cependant que le chômage technologique existait déjà en 1929 ! Oui, même à ce moment de production intensive ! Interrogez un homme compétent, M. Picquenard notre directeur de travail, il vous le confirmera.
— C’est épouvantable ! dit le propriétaire terrien.
— Mon vieil ami, continua Hermodan, ne vous lamentez pas. D’abord, c’est complètement inutile, puisque cela ne changerait rien. Ensuite, dites-vous bien que ce qui arrive devait fatalement se produire. Logiquement, si la science, grâce aux savants, aux inventeurs, aux praticiens, est parvenue à fournir à l’humanité une armée d’un milliard d’esclaves de fer, et une autre d’un milliard de chevaux-vapeur, ce n’était pas pour que disparaissent quelques millions d’hommes, sous prétexte que leur travail ne devenait plus nécessaire. L’homme, contrairement à ce que vous avez cru, n’était pas condamné au travail à perpétuité. Il a durement peiné jusqu’à ce qu’il possède cette armée d’esclaves matériels qui, désormais, vont travailler pour lui. C’est la grande relève qu’il attend, qu’il a préparée et qui, enfin, est en marche pour le débarrasser de la corvée du labeur. Pourquoi serait-ce épouvantable ? La civilisation antique ? Quelques hommes libres portés par un monde d’esclaves. Demain ? L’humanité toute entière sera ces quelques hommes libres, et la matière sera la multitude d’esclaves. Je ne vois vraiment pas là de quoi nous attrister et vous empêcher de dormir.
— Mais voyez les conséquences, dit le propriétaire terrien. Vous avez eu la précaution de nous dire que vous nagiez en pleine hypothèse ; je crois que vous nagez en plein communisme, et cela, sans vous en douter.
— Pas fatalement, dit Hermodan. Je vous ai dit que, pas plus que vous, je ne connaissais l’avenir. Nous souhaitons que le désordre qui règne dans le monde ne nous conduise ni à la guerre, ni à l’anarchie. De plus, nous voudrions bien que le régime capitaliste, au lieu de s’effondrer, consente à évoluer afin de tenir compte des progrès scientifiques. Je cherche dans quelle voie il pourrait s’engager pour sauver notre civilisation. Voulez-vous me permettre de continuer ?
— C’est bien inutile, dit le propriétaire terrien. Vous imaginez un régime où celui qui ne travaille pas aura les mêmes avantages que le travailleur. Vous donnez une prime à la paresse et vous comptez que quelques braves gens dans la tranchée, pour employer votre expression, vont se faire tuer pour permettre aux autres de se goberger à l’arrière.
— Oh ! fit Hermodan en souriant. Voilà un sentiment de pudeur qui vous honore, mais qui me paraît bien tardif. Si l’idée que des hommes peuvent vivre sans travailler est de nature à vous faire souffrir, vous avez dû souffrir beaucoup et depuis longtemps. Car vous avez certainement entendu parler de centaines de milliers d’hommes qui ont vécu bien tranquillement de leurs rentes. Peut-être en avez-vous connu personnellement. Des millions d’hommes ont vécu, et bien vécu, sans jamais rien faire de leurs dix doigts, ni de leur substance grise. Certains journaux s’étaient même spécialisés dans la description de leurs faits et gestes. Comment se fait-il que cette paresse, du moment qu’elle reposait sur de bonnes rentes, ne vous ait jamais choqué ?
— Leurs parents et leurs grands-parents avaient travaillé pour eux, dit le propriétaire terrien.
— Les parents et les grands-parents des chômeurs d’aujourd’hui ont beaucoup travaillé pour nous, répliqua Hermodan. C’étaient des millions d’hommes qui bûchèrent toute leur existence et qui nous ont fabriqué cette armée d’esclaves-matière. Dites que les chômeurs d’aujourd’hui sont les successeurs des rentiers d’autrefois, si cela peut vous soulager. Des rentiers infiniment moins privilégiés, du moins pour l’instant, que ne le furent ceux que nous avons connus et que nous connaissons encore. Car il est évident que notre société ne peut pas faire, demain, à celui qui devra vivre sans travailler, un sort supérieur, ni même égal, à celui qui lutte pour se faire une place au soleil. Je souhaite, au contraire, que l’on puisse toujours maintenir ces possibilités d’émancipation, de mieux-être, qui sont la force du régime capitaliste. Donc, notre nouvelle classe de rentiers, soyez-en bien persuadé, sera dans une situation très inférieure à celle qui disparaît sous nos yeux.
— C’est la collectivité qui va assumer cette nouvelle charge, interrompit le propriétaire terrien. Vous voyez bien que, malgré tout votre désir de sauver le capitalisme, vous sombrez, vous aussi, dans l’étatisation à outrance.
— Voire, dit Hermodan.
— C’est tout vu, répliqua le propriétaire terrien. Baptisez votre système du nom que vous voudrez, c’est encore et toujours de l’étatisme. Il est impossible de mettre le doigt dans l’engrenage sans que le corps y passe tout entier. Paul-Boncour, Léon Blum, Staline !… Je ne présente pas la France et les Français soumis à ce régime. Cela vous plairait, à vous, qu’à chaque geste économique, à chaque transaction ou autre opération, nous fussions inscrits, enregistrés, recensés, timbrés, mesurés, tarifés, cotés, patentés, autorisés, licenciés, empêchés, contingentés ! À la suite de quoi nous serions traqués, houspillés, contrariés, poursuivis, interrogés, emprisonnés, fustigés, sacrifiés, vendus, contrecarrés, bernés, découragés, outragés, déshonorés ! Grand merci !
— Voilà que vous recommencez à vous lamenter, dit Hermodan…
— Mais c’est à cet étatisme que l’on court, interrompit le propriétaire terrien, et à quelle allure ! Voyez ce qui se passe en Allemagne. Il y fait des progrès inouïs. La législation de crise a déjà placé sous le contrôle de l’État les banques, l’industrie lourde, les lignes de navigation et, pratiquement, tout le commerce extérieur. C’est l’État qui fixe la durée de travail et la rémunération des ouvriers, les loyers, le taux de l’intérêt, bientôt le prix de toutes choses. À Rome, c’est encore l’étatisation, qui se prononce « fascisme » en italien. L’emprise de cet étatisme est sans doute déjà plus forte qu’en Allemagne. Toute création d’industrie nouvelle et tout agrandissement d’industrie existante sont soumis à l’autorisation du Sénat. Un propriétaire n’est plus libre de cultiver son champ comme bon lui semble. La nature de ses cultures lui est en quelque sorte imposée par le gouvernement. S’il refuse, il est dépossédé au profit du syndicat agricole le plus voisin.
— Propriété oblige ! c’est le principe de Mussolini, dit Hermodan ; la propriété fasciste a pris un caractère nouveau, celui de la fonction sociale, et le propriétaire a des devoirs envers la collectivité.
— Communisme ! dit le propriétaire terrien.
— Pas nécessairement, répliqua Hermodan. […]«